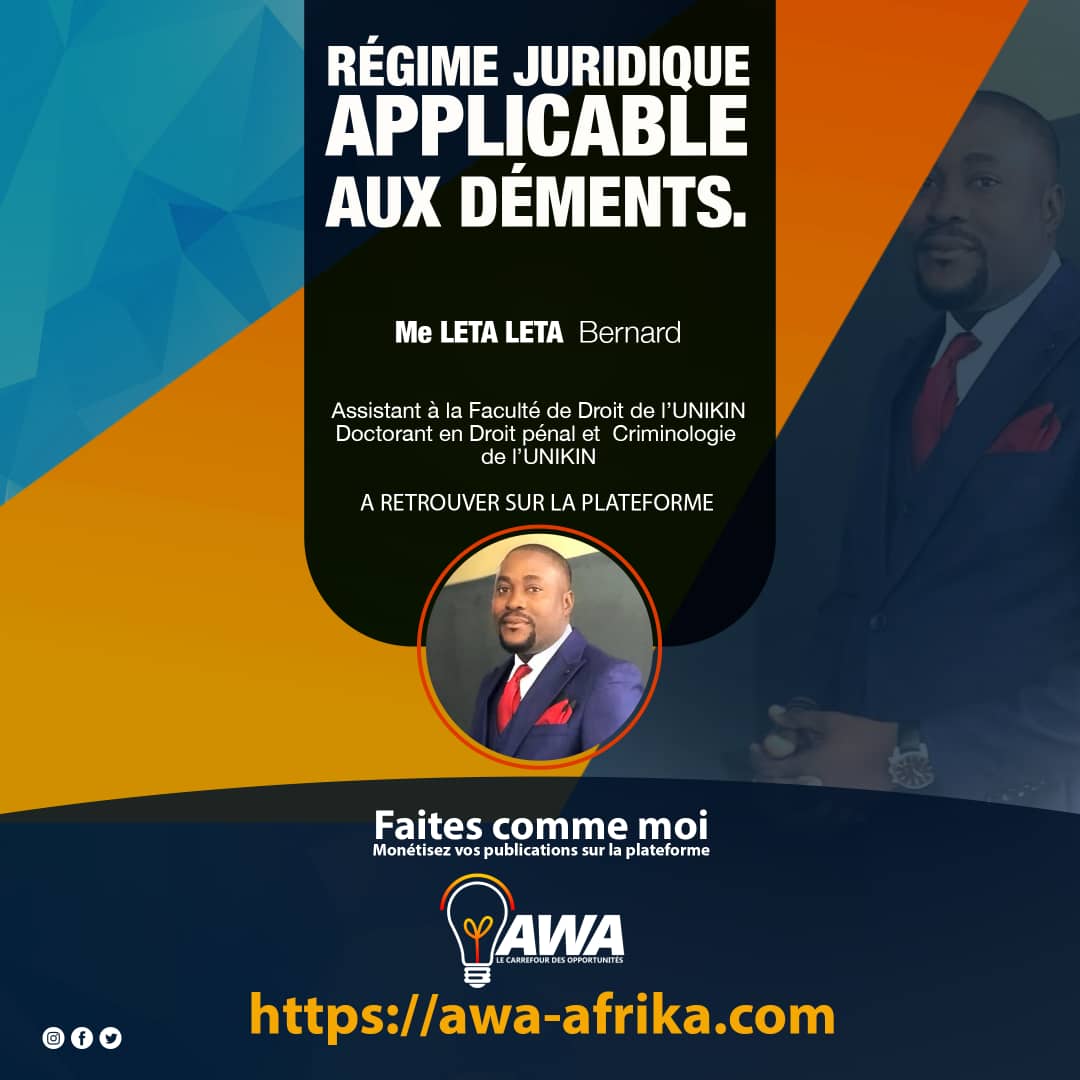
INTRODUCTION La folie n'est pas apparue au fil du temps, elle a toujours existé et il a fallu la traiter depuis les plus vieilles époques au sens juridique d'une part et au sens médical d'autre part. En droit congolais, comme dans tant d'autres droits, il existe des facteurs dits de “non imputabilité d'une infraction”; c'est-à-dire des circonstances qui font que malgré la commission d'une infraction, l'auteur ne puisse pas répondre de ses actes. Ainsi, parmi ces causes nous trouvons la démence. Cependant, si sur le plan strictement juridique, il est logique que le dément ne réponde pas de son fait, il est regrettable sur le plan criminologique que la seule solution reconnue dans notre droit soit l'acquittement pure et simple. En effet, quoi qu'il soit juridiquement irresponsable, le fou, n'en est pas moins socialement dangereux. Outre l'introduction et la conclusion, cette réflexion tournera autour de deux points le premier porte sur l'analyse des concepts clés et le second s'attarde sur la qualification des personnes démentes en droit. I. ANALYSE DES CONCEPTS CLÉS Dans ce point, il sera question d’examiner dans un premier temps, les notions générales de responsabilité pénale. Et en second lieu les notions relatives à la démence. Section 1: NOTIONS DE RESPONSABILITÉ PÉNALE La responsabilité pénale est l'obligation de répondre des infractions que l'on a commises et de subir la sanction pénale prévue par la loi, dans les conditions et selon les formes qu'elle prescrit. Et pour que la responsabilité pénale soit retenue, l'agent qui a vidé l'interdit pénal doit être doté, au moment de la commission de l'acte, de discernement et de conscience. Par-là, nous pouvons déduire que la responsabilité pénale se fonde sur le discernement ainsi que sur la conscience de l'auteur de l'infraction commise. Ainsi, la responsabilité pénale est à la fois définie par rapport à l'agent et par rapport à l'acte qu'il a commis. Elle s'exprime par l'équation:« imputabilité + culpabilité = responsabilité» qui suppose que toute infraction, même non intentionnelle suppose que son auteur ait agit avec intelligence et volonté. Cette considération s'étend jusqu'à la sanction pénale puisqu'elle influe sur le traitement qui sera décidé notamment en vue de la resocialisation du condamné. 1. Principe de responsabilité pénale Les règles de la responsabilité pénale posent donc en principe:« qu'il n'y a ni infraction, ni responsabilité pénale sans intention criminelle» et que sauf disposition expresse de la loi, est seul punissable, l'auteur d'une infraction qui agit intentionnellement. Le terme «agir intentionnellement», ici, n'est pas nécessairement réaliser un dol, mais c'est agir avec conscience et volonté en vue d'atteindre un résultat déterminé ou mettre en danger la personne d'autrui. La faute d'imprudence ou de négligence implique également une certaine part de conscience et de volonté dans la mesure où il peut être reproché à l'auteur des faits de ne pas avoir accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il dispose. Raison pour laquelle il est introduit en droit pénal Congolais le principe de précaution et son pendant, le devoir de prévention, tous deux étant implicitement institué par la constitution de 2006 qui à plusieurs reprises, charge l'État des devoirs particuliers. Delà, on peut tirer un autre principe celui de la responsabilité pénale pour que seule exonère la force majeure. Les règles générales de responsabilité pénale établissement enfin que l'ignorance de la loi pénale, le mobil, l'erreur sur la personne de la victime ou sur l'objet de l'infraction ainsi que le pardon de la victime sont sans conséquence sur la responsabilité pénale. Ils peuvent cependant être pris en compte dans l'appréciation par le juge de la mesure de la sanction. La responsabilité pénale, est comme reprise, ci-haut, l'obligation de répondre des infractions commises et de subir la peine prévue par les textes qui les répriment. Mais il faut préciser qu'il existe à ce principe une exception qui est : les cas d'exonération ou d'atténuation de responsabilité pénale qui atténuent ou suppriment la responsabilité pénale de l'agent. 2. Les cas d'exonération ou d'atténuation de responsabilité pénale Par cas d'exonération de la responsabilité pénale il faut entendre des circonstances qui font que malgré la commission d'une infraction, l'auteur ne puisse pas répondre de ses actes. Ainsi pour qu'un fait soit punissable, il ne suffit pas seulement de déterminer la loi violée, ni d'établir sa matérialité, mais aussi et surtout d'établir la responsabilité de l'agent qui l'a commis. Et par conséquent, Contrairement aux droits anciens, le droit pénal moderne ne frappe pas automatiquement l'auteur ou le complice d'une infraction. Celui-ci doit d'abord être reconnu pénalement responsable. Dire de quelqu'un qu'il est responsable, c'est-à-dire qu'il est en mesure de répondre de ses actes. Ainsi pour parvenir à cela, il convient de faire une différence entre les deux notions ci-après: la culpabilité et l'imputabilité. La culpabilité suppose la commission d'une faute au sens large dans le chef de celui qui a posé l'acte de commission ou d'omission. Cette faute est soit l'intention ou le dol, soit la faute au sens strict qui vise des comportements caractérisés par l'imprudence, la négligence, le défaut de précaution ou de prévoyance, ou le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité. L'absence de faute entraîne l'absence de culpabilité. La faute peut en aussi revêtir la forme de mise en danger délibérée d'un bien juridiquement protégé. Quant à l'imputabilité il faut dire que celle-ci doit être entendue comme la capacité de comprendre et de vouloir . Elle suppose donc la conscience et la volonté libre. Elle est liée à l'état psychologique de l'agent au moment de la commission de l'infraction. Nous sommes sans ignorer que les deux notions sont diamétralement opposées en ce sens que la culpabilité désigne une faute alors que l'imputabilité renvoie à la capacité de comprendre et de vouloir. Mais s'il faudrait rapprocher les deux notions on dira que la culpabilité précède l'imputabilité dans la mesure où il ne peut être reconnu une faute à l'égard d'une personne qui n'est pas imputable c'est-à-dire qui ne peut pas ni comprendre, ni vouloir de ses faits commis. Par-là, nous pouvons déduire que l'absence d'imputabilité entraîne l'absence de culpabilité. Mais il faut préciser que l'existence de l'imputabilité n'annonce pas toujours la faute, car l'agent conscient peut orienter sa volonté aux services du bien. Ainsi, il existe des éléments qui suppriment la capacité de comprendre et de vouloir de l'agent et qui rendent impossible aussi bien la culpabilité que la responsabilité pénale de celui-ci, et peuvent empêcher qu'une sanction pénale soit prononcée ou appliquée. Section 2: DE LA DEMENCE L'ancien code pénal français de 1810 en son article 64 appelait la «la démence»: une absence de discernement qui touche à cette sorte la liberté et la conscience morale, empêchant la responsabilité pénale. Mais, désormais aujourd'hui on parle, depuis le nouveau code pénal français de 1994 en son article 122-1 des troubles psychiques altérant ou abolissant la volonté de l'auteur de l'infraction. 1. Notions de la démence A. Historique de la démence entant que cause d'irresponsabilité pénale L'irresponsabilité pénale des déments est héritée du droit romain. A Rome, les fous étaient considérés comme irresponsables de leurs actes, lorsqu'ils les avaient commis en état de démence. En revanche, l'ancien droit, au moyen âge, n'avait pas cette sagesse bien que déclarant le “démens” ou le “furiosus” comme irresponsables. Sauf en cas de lèse- majesté, il n'hésitait pas à condamner les fous et parfois même à les punir plus sévèrement parce qu'il les considérait comme des Possédés par le diable. En effet, il n'y avait donc pas de solution unique, les fous étaient exposés aux peines de droit commun, sauf au juge de modérer celles-ci. Ainsi, par les travaux scientifiques de Pinel et Esquirol, pénalistes et philosophes, que l'opinion et les légistes ont reconnu l'irresponsabilité pénale des déments. Par leurs travaux, ils ont pu, suite à la doctrine classique qui fonde la responsabilité pénale sur le libre arbitre, ressortir le caractère injuste de ce système répressif ; car les aliénés n'ont pas de libre arbitre, pas de liberté morale. Ils ont également par leurs travaux, fait apparaître le caractère inutile de ce système, dans la mesure où, les aliénés mentaux ne sont pas capables de comprendre la sanction prononcée contre-feux. C'est aussi suite à ces travaux que le code pénal français de 1810 a résolu de combler le vide législatif provenant de la révolution française, en énonçant en son article 64 ce qui suit : «il n'y a ni crime, ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action». Mais il faut préciser que l'approche ici est juridique, et non criminologique en ce sens que le fous même s'ils sont jugés juridiquement irresponsables, représentent toujours une dangerosité pour la société. Cette disposition constitue une évidence, dans la mesure où elle énonce de manière claire, par rapport à l'ancien régime, l'irresponsabilité pénale du dément. Pour le professeur Rassat, dans la conception utilitariste qui était la sienne «il était normal que le code pénal français de 1810 fasse échapper les malades mentaux au droit pénal, car inconscient, le dément ne peut être inutilement, en effet, ni dissuadé, ni châtie». Mais cette disposition n'était pas exempt des critiques. La première difficulté était celle relative à la définition du terme "démence" car la définition de l'anormalité devrait en principe se faire par rapport à la normalité, or personne jusqu'alors n'est parvenue à donner une définition précise à l'homme normal. Cette question est le plus difficile du droit dans la mesure où elle se situe aux confins de plusieurs disciplines à savoir : le droit pénal, la criminologie, la médecine, et plus spécialement de la psychiatrie et de la science pénitentiaire. L'article 64 ne donnant aucun élément, il convenait donc de se tourner vers la science et la doctrine pour tenter d'établir un panorama des comportements pouvant conduire à l'irresponsabilité. On distinguait dès lors d'une part la folie générale et, d'autre part la folie spécialisée. La seconde difficulté est celle basée sur la question relative à la formulation " il n'y a ni crime, ni délit..." Cette formulation fait disparaitre même l'infraction, alors que dans ce cas de figure, l'infraction existe bien, qu'elle ne disparaît pas. La preuve en est que le complice ou le coauteur du dément qui ,lui, est saint d'esprit bien entendu sera condamné , parce que n'étant pas concerné par cette cause d'irresponsabilité. En outre, au regard de la réparation civile, l'infraction et ses conséquences existent bien. Par la suite, la logique adoptée par l'article précité était vivement critiquée par la doctrine, car plusieurs auteurs ont cherché d'autres solutions, d'autres moyens de prendre en charge juridiquement et médicalement les auteurs d'infractions atteints de troubles mentaux. Certains préconisaient la mise en place de régime mi détention classique, mi hospitalisation. D'ailleurs, pour les écoles psychiatriques modernes, le malade mental n'est véritablement, en fait, ni totalement inconscient, ni tout à fait inaccessible à la sanction. Mais aucune de ces idées n'a véritablement abouti puisque le code pénal français de 1992 n'a suivi ni les travaux doctrinaux, ni le projet du code pénal de 1978 qui préconisait également un régime d'emprisonnement adapté à la maladie et à la psychologie des individus les intégrant. C'est à l'article 122-1 du code pénal français que le droit positif prend en compte les troubles mentaux au moment de la commission d'une infraction. C’est ainsi que l'article 122-1 énonce : «N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou entravé le contrôle de ses actes. La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et fixe le régime». Ainsi c'est par l'art énoncé ci-dessus, que le droit pénal congolais, bien que ne consacrant aucune disposition quant à l'irresponsabilité pénale du dément, l'applique dans le contexte des principes généraux de droit. B. Définition de la démence Il revient à préciser qu'il n'existe pas une unanimité autour de la définition du terme "démence". Et il sied, de ce fait, de souligner qu'il existe plusieurs définitions du mot démence. Ainsi sans recourir à la notion qu'ont les médecins ou les psychiatres de ce terme, nous dirons qu'au sens du droit pénal, la démence «désigne toutes formes d'aliénation mentale». Sur le plan doctrinal, plusieurs définitions ont été données, parmi lesquelles nous pouvons échantillonner : - la démence désigne tous les états où le jugement est manifestement troublé par les altérations importantes de la perception et des associations des idées. - la démence désigne tout désordre pathologique grave qui aliène les facultés de discernement et le contrôle de celui qui en est atteint. Dans sa conception, le professeur Nyabirungu Mwene songa souligne que: «le terme démence vise les troubles innés de l'intelligence tels que le crétinisme, l'idiotie ou l'imbécillité, comme les troubles acquis par l'effet de la maladie, tels que la paralysie générale ou la démence précoce. Elle vise la folie spécialisée ou localisée. Par folie spécialisée, il faut entendre des manies spéciales qui affectent certains individus et les conduisent à commettre un type déterminé d'infractions. C'est le cas de la kleptomanie ou de la pyromanie». 2. Etats voisins de la démence A côté de la démence proprement dite, il existe divers troubles nerveux, pathologiques ou provoqué, et à propos desquels la question de leur incidence sur la responsabilité pénale peut se poser. Il existe cependant, deux(2) catégories. Nous avons d'une part les situations ignorées, et, d'autres parts les intoxications d'origine volontaires. Parmi les situations ignorées nous avons: le somnambulisme, l'hypnose, la nervrosité , l'hypersensibilité, la neurasthenie, la dépression, la folie morale. Au nombre des intoxications d'origine volontaires nous avons: les intoxications dues à l'absorption de drogues dans tous les sens du terme et surtout celle d'alcool, notamment l'ivresse,... Sans devoir les aborder tous, dans le présent travail, nous nous bornerons que sur la notion du somnambulisme ainsi que celle de l'ivresse. A. Le somnambulisme Le somnambulisme s'entend comme une série de mouvements, d'actes automatiques et inconvénients se produisant pendant le sommeil, et dont aucun souvenir ne reste au réveil. Ainsi, le somnambule est celui qui est atteint du somnambulisme. Le somnambulisme a pour effet de rendre irresponsable pénalement l'auteur, qui étant sous l'emprise de ce dernier, accomplit inconsciemment et irrésistiblement des actes constitutifs d'infractions. En revanche, on pourrait reprocher un délit d'imprudence à celui qui, se sachant naturellement somnambule, aura commis une faute lorsqu'il était à l'état normal, la quelle faute entraîne indirectement la commission d'une infraction lors de l'état léthargique. En guise d'illustration, on se réfère souvent à l'agent qui se couche avec un revolver à la portée de sa main, et qui tue quelqu’un lorsque la crise survient. Dans ce cas, il ne répondra pas de l'homicide volontaire, mais pourra bel et bien être condamné pour homicide involontaire. B. L'ivresse L'ivresse implique diverses situations et des solutions variées. Certes, elle diminue voire annihile les facultés de discernement mais cela ne suffit pas pour qu'on la déclare sans nuance ; cause de non imputabilité. Elle est érigée en infraction par l'ordonnance n°57/Apj du 10 juin 1939 qui puni l'ivresse publique et par le nouveau code de la route qui punit en son article 104, la conduite en état d'ivresse. Par ivresse, il faut entendre un trouble cérébral passager causé par l'absorption d'un excitant quelconque : Alcool, chanvre, opium etc. Ainsi, on distingue d'une part l'ivresse publique et d'autre part l'ivresse au volant. L'ivresse est publique lorsqu'une personne apparemment Ivre est trouvée dans les rues, places, chemin, débits de boissons, salles de spectacles et autres lieux publics ainsi que les lieux non clôturés sur lesquels le public peut voir directement vue. L'ivresse au volant quant à elle, est le cas d'une personne qui conduit alors qu'elle se trouve en état manifeste ou se trouve sous l'Empire d'un état alcoolique. L'ivresse est unanimement considérée comme une cause de non-imputabilité lorsqu'elle est complète et involontaire. II. LE REGIME JURIDIQUE APPLICABLE AUX DEMENTS Par régime juridique il faut entendre un ensemble de règles de droit applicables à une activité, une personne ou à une institution. Un régime s'applique lorsque ses conditions sont réunies. Ainsi, l'appellation d'un régime suppose donc que, préalablement à l'application d'une règle, soit précédé à l'opération de qualification juridique. Ainsi, au regard de ce qui précède, nous dirons qu'en droit congolais, tout comme dans tant d'autres droits ,la qualification juridique qui revient aux déments est que les déments sont irresponsables pénalement, mais sur le plan purement civil ,ils demeurent responsables de leurs actes.
Télécharger l'intégralité de l'article içi Cliquer içi pour voir le profil de l'auteur